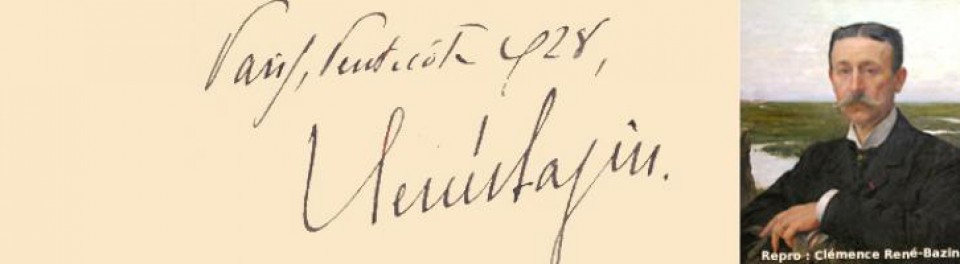A Paris, le 27 mars 2011
Alain Lanavère, maître de conférences à la Sorbonne
René Bazin : un romancier qui ne « bluffait » pas.
René Bazin, depuis plus d’un demi-siècle, subit une étrange malédiction. Le Livre de poche d’après-guerre ne l’édita pas; les bons manuels de littérature d’alors, comme le «Lagarde et Michard», s’ils l’évoquaient à côté de Paul Bourget, ne fournissaient aucun extrait de ses oeuvres. Les historiens du roman hésitaient à classer ses livres : romans de la terre ? littérature régionaliste ? romans catholiques ? traditionalistes ? bourgeois ? études de moeurs ? Et aujourd’hui, beaucoup d’ouvrages universitaires ne mentionnent même plus son nom. Si Bazin fut de son vivant même loué par des écrivains (ainsi François Mauriac lui consacra en 1931 une étude de près de cent pages, ainsi Georges Bernanos souscrivit en 1929 à la plaquette de son jubilé académique), si plusieurs ouvrages flatteurs, dont quelques thèses, lui furent voués après sa mort en 1932, et si Calmann-Lévy, son éditeur, continua de diffuser ses romans auprès d’un grand lectorat, nulle école littéraire ne se réclama de lui. Et, peut-être pire, aucune ne le combattit : il n’eut pas l’honneur, si l’on peut dire, d’être brocardé autant que le fut Paul Bourget, les surréalistes ne pensèrent pas à l’insulter autant qu’ils le firent pour Barrès ou Anatole France, et son petit-neveu Hervé Bazin (Prix Lénine de la paix en 1979 !) n’eut pas l’idée de médire de lui. D’où une sorte d’obscurité qui, aujourd’hui, plane et même stagne sur l’homme comme sur l’oeuvre. Très peu de titres de lui, auteur pourtant à succès, se trouvent encore en librairie (malgré les efforts de petits éditeurs, comme les éditions Siloé ou de. La Déouvrance).
Et pourtant…! Auteur de dix-neuf romans (qui s’étalent de 1884 à 1931), de seize recueils de contes et chroniques, de cinq récits de voyage et de sept biographies (sans compter ses études sociales et littéraires), René Bazin mériterait de notre part mieux que de l’estime.
Des romans variés
Parce qu’il professa longtemps le droit à Angers et qu’il y résidait plus bien volontiers qu’à Paris, parce qu’il est l’auteur de contes cadrés en Anjou (Paysages et pays d’Anjou, 1927), Bazin passe pour le peintre de sa seule province. Mais ses romans sont autrement divers. Pour quelques titres dont les intrigues son en effet sises en Anjou (Stéphanette, Ma Tante Giron, Davidée Birot), la majeure partie témoigne d’une curiosité du romancier pour bien d’autres contrées : Boulogne-sur-Mer dans Gingolph l’abandonné, Nantes et ses ouvriers dans De toute son âme, le Nivernais dans Le Blé qui lève, Mézillac et le golfe du Morbihan dans Magnificat, l’Alsace dans Les Oberlé et la Lorraine de la frontière sarroise dans Baltus le Lorrain, Bourges, Paris et l’Italie dans La Tache d’encre, l’Angleterre, Paris et Rome dans La Barrière, le Marais vendéen dans La Terre qui meurt, la Vendée angevine avec Les Noellet, divers coins de Bretagne avec Donatienne et Madame Corentine, etc.
Bazin passa son enfance à la campagne, non loin de Segré; connaissant la terre et l’aimant, il consacra plusieurs livres à la vie paysanne (La Terre qui meurt) ou encore forestière. Néanmoins, il sut peindre les industries du bois vosgiennes, la grande pêche au hareng et au maquereau, les ateliers de la mode à Nantes, la vie des carriers de la Creuse et des ardoisiers de Trélazé, le forestage nivernais, la condition des nourrices bretonnes à Paris, l’exode rural, l’évangélisation de la «zone» au Kremlin-Bicêtre, les déconvenues des institutrices laïques, la décadence morale de l’aristocratie terrienne, la vie mondaine parisienne, etc. Sa culture de juriste, sa sympathie pour le catholicisme social de Mgr Freppel et de La Tour du Pin, ses activités de conférencier dans plusieurs cercles catholiques d’Angers, ses voyages, ses activités caritatives, l’accueil qu’il sut réserver aux encycliques sociales de papes comme Léon XIII le portèrent à élargir progressivement son inspiration et d »écrire, comme le disait Albert Thibaudet, «des romans dont le sujet était dans l’air politique et social, et de s’en tirer fort bien».
En effet, sa carrière d’écrivain, qui fut longue (son premier roman, Stéphanette, parut en 1884, le dernier, Magnificat, en 1931) dessine la courbe d’une sorte d’élargissement, et tout à la fois d’approfondissement. Ses trois premiers livres, Stéphanette, Ma Tante Giron (1886), Une Tache d’encre (1888), parus dans la presse en feuilletons, sont d’aimables fantaisies, inspirées et du terroir angevin, et du légendaire familial de René Bazin (qui s’honorait d’ancêtres qui avaient «chouanné»); le pittoresque y règne, le romancier y collectionne avec tendresse des traits de moeurs de l’ancienne France, et caricature au passage quelques personnages ridicules avec un humour à la fois fin et plein d’indulgence; les intrigues, conduisant au mariage de beaux et vertueux jeunes gens, ne sont pas exemptes de coups de théâtre, mais ce romanesque exempt de vrai suspense donne agréablement à sourire. Ces romans de jeunesse, auxquels on peut joindre le conte de La Sarcelle bleue (1892), dont les mérites avaient attiré sur lui l’attention d’Académiciens français, comme Brunetière, lui ouvrirent les colonnes du Correspondant, du Journal des Débats et de la prestigieuse Revue des Deux Mondes; Bazin ne les désavouera jamais et les laissera paraître dans des collections réservées à la jeunesse.
Encouragé par Brunetière, par Ludovic Halévy, par Melchior de Voguë, et très soucieux de problèmes sociaux qu’il étudiait avec ses étudiants de la «Catho» d’Angers et qu’il ne traitait qu’après de solides enquêtes sur le terrain (aussi sérieuses, sinon davantage, que celles que se vantait de faire Zola), René Bazin se lança avec Les Noellet (1889) dans une autre sorte de roman : l’histoire d’un petit paysan de la Vendée angevine, hypocrite, intelligent et ambitieux, qui pour s’élever simule une vocation ecclésiastique, et croit pouvoir à Paris voler de ses propres ailes; l’échec est lamentable et le père Noellet, ruiné d’avoir dû payer les vaines études de ce fils, accourt à Paris le ramener à la métairie qu’il quitta naguère si orgueilleusement.
À partir ce ce premier roman «social», René Bazin va aligner une belle série d’études, romanesques certes, puisque s’y trouvent des drames familiaux et des affaires de coeur, mais aussi centrées sur les crises du XIX° siècle finissant : Donatienne (1894) raconte les lamentables aléas de la vie des petites Bretonnes «montées» à Paris pour y être nourrices, De Toute son âme (1897) la dure condition des ouvrières de la mode à Nantes, La Terre qui meurt (1899) la désertion des campagnes aussi bien par sa noblesse que par les enfants des métayers, Les Oberlé (1901) le drame des Alsaciens soumis depuis 1870 à la Prusse et à sa dure politique de germanisation. Le succès de ce dernier roman valut à Bazin d’être élu à l’Académie française en 1903, et, fort de ce nouveau prestige, il osa dans L’Isolée (1905) flétrir la politique anticléricale de Combes qui jetait dans la rue les religieuses des convents; Le Blé qui lève (1907) disait les illusions et les violences des syndicats du bûcherons dans une Nièvre déchristianisée; La Barrière (1909) condamnait le catholicisme de façade de la bourgeoisie parisienne, arriviste et égoïste; Davidée Birot (1911) peignait les inquiétudes d’une jeune institutrice laïque que ne satisfait plus l’indigente et hypocrite morale républicaine qu’elle était censée enseigner; Gingolph l’abandonné (1914) dressait un tableau remarquablement précis des métiers de la pèche à Boulogne-sur-Mer; Champdolent 1917) est un roman sur les drames familiaux liés à la guerre; Baltus le Lorrain (1926) stigmatise les velléités de Blum et d’Herriot, au pouvoir depuis 1924 avec le Cartel des Gauches, d’imposer à la Lorraine récemment libérée du joug allemand la législation scolaire antireligieuse. Magnificat enfin, son dernier roman (1931), évoque la difficile vocation sacerdotale, après guerre, d’un rural qui, lui aussi, mais pour de hautes raisons (évangéliser les banlieues rouges), quitte sa famille et sa terre.
Des romans vrais
Par tempérament et goût littéraire personnel, et sans doute aussi parce qu’il enseigna le droit (la procédure civile, puis le droit criminel) durant quarante ans, René Bazin se piquait de réalisme. Il lui arrive, quand il se fait critique littéraire (Questions littéraires et sociales, 1906) de dire du bien de l’exactitude de Flaubert, de Tourguenieff, d’Alphonse Daudet, voire de Maupassant. Comme eux, et comme les naturalistes (on oublie qu’il n’avait que treize ans de moins que Zola), il n’écrit rien sans s’être informé, avoir séjourné sur les lieux, et même plusieurs fois (ainsi pour Les Oberlé), avoir rempli ses carnets de notes très précises, de schémas, voire de croquis. Quand on lui objecta que l’intrigue de L’Isolée était invraisemblable (une religieuse chassée par la République laïque de son couvent et sombrant dans la prostitution pour finir assassinée), il produisit tout de suite un dossier de presse prouvant que de tels faits étaient bel et bien advenus.
Ce qui le distingue – et le sépare – des réalistes, c’est, on s’en doute, ses convictions chrétiennes. Il se refuse à noircir, comme Zola et ses disciples le faisaient, sa représentation du monde humain et social. Dans son essai Questions littéraires et sociales (1906), il écrit : «Si j’avais à juger l’école naturaliste […], je dirais que son principal défaut littéraire a été de méconnaître la réalité : je montrerais ce qu’il y a de contraire aux règles de l’observation et de la sincérité, dans le procédé qui consiste à ne peindre de l’homme que les instincts, à supprimer les âmes, à expliquer le monde moral par des causes inégales aux effets, à murer toutes les fenêtres que l’homme, accable tant qu’on le voudra par la misère, le travail, la maladie, l’influence du milieu, continue et continuera d’ouvrir sur le ciel. Car il y aura toujours de ces fenêtres-là, par où la prière monte et l’espérance descend.» Pour Bazin, parce qu’il l’a observé, aucun déterminisme ne pèse sur l’humanité qui conditionnerait nécessairement et sa vie morale, et sa destinée historique; en d’autres termes, Bazin est, par sa foi catholique comme par son expérience, tellement persuadé de la survie en chacun d’une liberté qu’il ne se résout jamais, si misérable ou coupable que soit l’un de ses personnages, à l’abandonner au bout de son chemin sans au moins esquisser en lui un regret, un remords, et conjointement une espérance : c’est que tantôt le personnage se souvient obscurément de l’éducation heureuse qu’il reçut naguère (le plus souvent de sa mère), ou que tantôt il reste encore sensible au dévouement et à l’exemple que lui offrent, proches de lui, de bonnes gens, de braves gens, aussi pauvres que lui sans doute mais capables encore d’un peu de bonté. La psychologie de Bazin se veut exacte, qui reconnaît en tous, mais surtout chez les gens du peuple, même d’un peuple largement déchristianisé, et spécialement chez les femmes, une générosité, une compassion, une patience dans la souffrance, une endurance encore qui, sans que ses romans, il s’en faut, se terminent forcément par un happy end, en font des oeuvres qui tiennent en échec le désespoir.
Sa méthode le portait au reste à ne pas s’enfermer dans le moindre déterminisme. Soucieux de ne pas choquer ses lecteurs, il avait l’habitude de donner lecture devant des étudiants et des proches des dernières pages du roman qu’il avait en chantier, et il tenait compte des réactions de ses auditoires. Il se voulait aussi un romancier populaire (il voyait là une sorte d’apostolat), susceptible d’intéresser, d’instruire et d’émouvoir tous les publics; presque tous ses romans, avant d’être édités en volume, paraissaient ainsi chapitre après chapitre dans de grandes revues, ce qui lui valait un copieux courrier de ses lecteurs : il mesurait s’il avait, comme c’était son ambition, touché tous les âges, tous les milieux, toutes les cultures. Fort lucidement, puisque son réalisme l’obligeait à peindre une humanité large et vraie, il s’est posé la question de la peinture du mal, et l’a résolue ainsi : «Obligé de dire le mal, le romancier doit en éveiller l’idée sans en exciter le désir», et, sur ce point difficile, «le seul guide qui ne trompera pas, c’est une conscience affinée, respectueuse des âmes, et, pour tout dire, le tact chrétien de l’auteur». Ce tact, il n’en manquait certes pas : catholique fervent qui avait osé faire retentir en pleine Académie française le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, excellent époux et père d’une nombreuse famille, ami fidèle et dévoué, travailleur probe, il disposa en effet de l’art, que lui envia le jeune Mauriac, de suggérer le péché – toutes sortes de péché, pas seulement comme chez nombre de ses contemporains le seul péché de chair – sans jamais le parer d’une équivoque séduction. Car ses pécheurs et pécheresses ne sont chez lui jamais livrés entièrement au mal, des parties d’eux-mêmes y résistent encore; mieux, ces pauvres personnages continuent d’avoir des relations avec certains de leurs proches qui, eux, leur offrent un peu de leur bonté. Même si chez lui reviennent un peu trop souvent des personnages de mères exemplaires et de pures jeunes filles (modelées, dirent ses proches, sur son épouse) résolues à se sacrifier, il nous semble que sa psychologie est plus véridique que celle de ses contemporains Paul Bourget (qui, disciple de Stendhal en l’occurrence, analyse les coeurs comme autant de mécanismes complexes, mais abstraits) et Henry Bordeaux (dont les héros ont trop de sentiments, et trop bons).
Quant à ses goûts littéraires intimes, ils ne pouvaient gêner René Bazin, puisque certes informé du mouvement des lettres en son temps (il admirait Claudel), il les sacrifia. Au sens où ses romans restent extraordinairement indifférents aux modes qui se succédèrent durant le demi-siècle où notre romancier écrivit. À croire que n’avaient paru ni les symbolistes, ni les décadentistes fin-de-siècle, ni les esthètes de la Nouvelle Revue Française qui rêvaient de rénover les formes du roman, ni Proust, ni toutes les avant-garde qui, de part et d’autre de la Grande Guerre, se bousculèrent. Le dernier, et fort beau, roman de Bazin, Magnificat, date de 1932 : il n’a (et c’était délibéré de la part de son auteur) aucun rapport avec tel ou tel titre contemporain : Regain de Giono (1931), Voyage au bout de la nuit, de Céline, Le 6 octobre, de Jules Romains (c’est le premier tome des Hommes de bonne volonté), Claire de Chardonne, Le Noeud de vipères de Mauriac (tous romans parus en 1932), La Condition humaine, de Malraux (1933). Bazin se défiait de toute recherche formelle, de toute sophistication dans l’expression, d’intrigues alambiquées ou tarabiscotées, des psychologies bizarres ou monstrueuses, des décors surréels pour ne pas dire surréalistes, il lui suffisait d’être limpide, simple, exact, véridique – faut-il dire : classique ?
Le peintre de la nature
Bazin gardait de sa première enfance rurale un souvenir très précis, il vivait aux portes d’Angers très près de la campagne. Jeune, il avait écrit des vers et s’était enchanté du lyrisme de Lamartine et de Hugo. Surtout, il ne cessa d’être tenté par la peinture, de fréquenter des peintres, de voir et d’étudier de la peinture. On ne s’étonne donc pas trop de découvrir dans ses romans d’amples descriptions, très prenantes, de la campagne, des bords de mer, des saisons et des ciels qu’elles modifient. Sa technique, très louée en son temps, n’est pas simple. Tantôt, semblant relayer en personne ses personnages, il brosse tout un paysage, champs lourds de moissons, mers changeantes, forêts profondes et sonores : ces pages, très nettement structurées, colorées avec soin, offrent une foule de détails très précis où se devine la compétence du promeneur, du voyageur, du chasseur (Bazin l’était passionnément), et semblent dignes de figurer dans des anthologies. D’aucuns ont trouvé ces pages trop «léchées»; mais ce jugement n’est pas fondé. Quand de telles pages se présentent dans les romans de Bazin, c’est toujours en un endroit précis où le romancier veut faire respirer son lecteur, jusque là pris dans l’intrigue et confiné dans le drame du personnage; surtout, Bazin veut suggérer, par ces échappées sur la nature, que son personnage, confronté à l’échec, pour l’heure souffrant et étouffé, ne saurait se résigner à son malheur, puisque au-dessus de lui s’ouvrent de vastes ciels, que la mer changeante se met à briller, que les saisons travaillent profondément les champs et les bois; contrairement aux apparences, ces beaux morceaux descriptifs ne sont en rien gratuits dans l’économie de nos romans, ils les ouvrent et ouvrent les personnages à une nature qui, mieux que les sociétés humaines et les coeurs de bien des hommes, conserve en elle la trace de son créateur infini.
Le plus souvent, au reste, la description du paysage chez Bazin se morcelle. C’est que, choisissant le plus souvent pour héros des gens simples, Bazin savait bien qu’ils n’avaient pas sur la nature le regard d’un artiste peintre, et que presque toujours les mots mêmes leur manquaient pour dire la terre ou la mer sur laquelle ils travaillaient et vivaient. Plutôt que de confectionner une langue prétendument populaire, en réalité vulgaire autant qu’artificielle, plutôt que d’inventer un lyrisme agreste (Giono) ou plébéien (Céline), ou de lester ses discours de termes patoisants ou archaïques, Bazin, il s’en explique dans ses essais critiques, a fort sagement tenté de faire parler paysans, bûcherons et marins comme l’observation lui prouvait qu’ils parlaient : peu, sobrement, en phrases courtes, très ponctuées, un peu répétitives, lourdes de sous-entendus. Un paysan chez Bazin, par prudence et pudeur parle peu de sa terre, qu’il aime à reconnaître mais qu’il n’a pas à découvrir. D’où, par exemple dans La Terre qui meurt, de rapides passages descriptifs, leitmotive rythmant tout le livre, et formant à la longue un paysage obsédant et mystérieux, celui du Marais vendéen auquel s’accordent les paysans qui veulent encore y vivre :
«Les deux frères ne se parlèrent plus. Tous deux, vaguement, et poussés par l’instinct, ils regardaient le Marais où les derniers rayons du jour s’éteignaient. Au-dessous des terres plates, le soleil s’abaissait. On ne voyait plus, de son globe devenu rouge, qu’un croissant mordu par des ombres, et sur lequel un saule d’horizon, un amas de roseaux, on ne sait quoi d’obscur, dessinait comme une couronne d’épines. Il disparut. Un souffle frais se leva sur les collines. Un grand silence se fit. Des feux s’allumèrent, çà et là, dans l’étendue brune. La paix renaissait : les douleurs, une à une, finissaient en sommeil ou en prière du soir».
Par souci d’exactitude, Bazin s’est interdit de trop faire chanter ses phrases (il avait trop lu et aimé Chateaubriand pour ne pas se méfier de ses superbes cadences), mais ce que ses tableaux perdent en musique, ils le gagnent en précision. Pourtant, ce réalisme de Bazin n’en est pas tout à fait un : s’il accorde, fidèle à la technique balzacienne, le personnage et le paysage (qui est aux couleurs de l’humeur de celui qui y évolue), on a tôt fait de remarquer chez lui une prédilection pour les eaux en mouvement, les reflets changeants, les bourrasques imprévues, les nuages qui défilent, les brumes qui s’effilochant, finissent par se déchirer, les heures ou les saisons qui brusquement modifient formes et couleurs. Comme s’il voulait offrir à ses personnages (et à ses lecteurs) le spectacle d’une nature en liberté, il laisse leurs regards se perdre dans d’infinis lointains, échappatoires sans doute à toutes leurs misères. Il y a là, dans ces romans de Bazin que l’on croit trop vite si sages, un élément poétique tranchant heureusement d’avec leur précision réaliste. Bazin, épris comme tout catholique de transcendance, devait sûrement rêver que ce bas-monde, du moins certains de ses paysages campagnards, en fournissait un signe ou une image. Qui ne voit qu’avec de tels décors, grisants pour l’imagination, l’on est à cent lieues de strictes représentations de la vie de province ou de simples romans régionalistes ?
La douce France
Ce titre de Bazin (un recueil de contes et nouvelles à l’usage de la jeunesse des écoles chrétiennes, 1911) nous permettra de saluer un nouvel aspect de notre auteur : son patriotisme. Il écrivit trois romans sur les souffrances des Alsaciens ou des Lorrains sous l’occupation allemande; comme Barrès et d’autres, il multiplia pendant la Grande Guerre articles et initiatives en faveur de l’unité des Français face à la menace. Mais dès ses premiers romans, ce monarchiste de coeur, dont les ancêtres avaient «chouanné» avec Stofflet, avait su saisir presque amoureusement certains traits de moeurs de la vieille France d’Ancien Régime qui en plein XIX° siècle, voire au début du XX°, se conservaient en province, mais dans le peuple plus encore que dans l’aristocratie terrienne. Précis comme à l’accoutumée, Bazin met en scène les dévotions populaires de la Bretagne, de la Vendée, de l’Anjou ou du Boulonnais, les rites intimes de familles restées chrétiennes, d’où un certain pittoresque nostalgique qui ferait de lui un écrivain régionaliste si, le plus souvent, il n’insistait sur les grands traits de notre identité nationale : le goût de «la belle ouvrage» chez nos artisans, paysans et même ouvriers, le respect de la parole donnée, le sens du sacrifice (dont le courage des poilus au front prouvait qu’il ne s’agissait pas d’un vain mot), l’attachement au «pays» natal, certaines vertus de sociabilité et de fraternité palliant les clivages et les antagonismes de classe. Dans ses romans, Bazin exalte le plus souvent les vertus toutes françaises, dit-il, de personnages féminins : ce sont les mères, les jeunes filles aussi, qui, «de bonne race», maintiennent humblement et sans le savoir diffusent autour d’elles un catholicisme intimement vécu et qu’elles tiennent de leurs ancêtres. Dans Magnificat, le seul fils qui après la guerre est encore vivant devrait succéder à son père pour tenir la ferme, mais une vocation religieuse l’éloigne des siens : sa mère l’accepte, et résout son mari à l’accepter; surtout, Anna, la servante de la ferme, amoureuse du garçon, se sacrifie héroïquement (elle offre à Dieu sa déception et sa souffrance) et se résout à disparaître du chemin qui conduit le jeune homme au séminaire : «Mon Dieu, dit-elle, je renonce à mes enfants. Je renonce à ma jeunesse. Je renonce à être aimée. Je ne me marierai jamais […]. Protégez-le de la guerre et ramenez-le. Pas pour moi, pour vous… Vous ne pouvez pas me refuser. Je demande votre gloire». Bazin, en bon catholique, certes croyait vraie la thèse théologique de la réversibilité des mérites, mais il semble que pour lui, c’est en France mieux qu’ailleurs, et dans les tréfonds du peuple de France, que cette thèse se réalisait le plus sûrement.
La politique intéressa, bien sûr, René Bazin. Avec une belle hauteur de vues, il dénonça dans ses livres la germanisation forcée de l’Alsace et de la Lorraine, les navrants effets sociaux et moraux de la politique anticléricale des Républicains, la pourriture du parlementarisme, l’hypocrisie de la prétendue morale laïque et obligatoire, le cynisme du patronat et de la bourgeoisie affairiste, la démagogie des syndicats révolutionnaires. Trop chrétien pour goûter les violences de l’Action française, il se résigna sans illusions à la République, escomptant que le renouveau du catholicisme (la guerre de 1914 lui donna raison) finirait par changer intimement les coeurs des Français et ainsi leur apprendrait à mieux vivre ensemble, patrons et ouvriers, propriétaires et salariés, Parisiens et provinciaux. Ses traits les plus durs, lui qui passa pour un «romancier bourgeois», il les réserva à l’aristocratie qui déserte ses châteaux et ses terres pour se dissiper à Paris en mondanités stupides (le Jockey Club, les duels, les spectacles), au patronat égoïste, aux politiciens bornés, à la bourgeoisie ne pratiquant qu’un catholicisme convenu et de façade. À ces personnages, il oppose victorieusement le troupeau, bien français, de braves gens chez qui la France, la vraie, celle de nos saints et de nos rois chrétiens, pas celle de 1789, s’incarne encore et toujours.
Au total, cette oeuvre aujourd’hui encore touche; encore faut-il se donner la peine de la lire ou relire. Elle fournit d’abord le portrait moral d’un homme, René Bazin en personne, homme des plus estimables et aimables; même s’il était pudique, et ne se livrait pas dans ses livres comme tant de nos contemporains atteints d’exhibitionnisme, le lecteur ne peut que lui être reconnaissant pour sa modestie, sa mesure, la fraîcheur de sa foi religieuse, la justesse de son regard sur les hommes et les choses, sa conscience professionnelle, sa délicatesse morale. Ensuite, il ne peut que séduire quiconque aime lire une histoire, une bonne et belle histoire, narrée sans affectation d’originalité, sans bluff, sans esbroufe; ses romans ont le charme d’une simplicité qui n’est pas pauvreté, et sont solides sans paraître fabriqués. Nous avons noté aussi qu’ils s’agrémentaient fort souvent de pages remarquablement poétiques, échappées sur une nature presque surnaturellement vivante et belle. Historiquement, le témoignage de R. Bazin sur son temps, qui n’est certes plus le nôtre, a beaucoup à nous apprendre sur la vie et les vertus de nos aïeux, surtout si nous sommes dupes des images que l’histoire officielle (et donc truquée) nous laisse de ce passé. Enfin, sa façon de résoudre les difficultés du métier de «romancier catholique» ne peut laisser indifférent : il n’a pas cherché à révolter, à scandaliser, il n’a pas polémiqué, il ne s’est pas pris pour un prophète, il n’est jamais choquant, ni équivoque, ni complaisant, mais fait, discrètement, briller le bien où, vraisemblablement, il peut se trouver : au coeur d’un enfant, chez une mère, chez celui qui souffre et tente de porter vaillamment sa souffrance, chez celui qui du meilleur de lui-même travaille à sa tâche, chez celui qui sait un instant regarder la terre de France. Le public d’aujourd’hui, repu des fortes nourritures qui lui ont réservées les romanciers du XX° siècle, s’est détourné des romans de Bazin. La raison en parait évidente, c’est que ces livres sans aspérités, sans bizarreries, sont écrits dans une langue ferme et précise mais (volontairement) sobre, un peu grise, comme neutre (Bazin voulait être compris et aimé de tous), sans luxuriance ni la moindre affectation d’originalité; peut-être est-ce là la rançon de tout art qui refuse de s’afficher et qui même cherche à s’humilier au profit exclusif de la clarté de l’expression. René Bazin en son temps mérita, pour ces raisons mêmes, un grand succès populaire, et voilà qu’aujourd’hui, paradoxalement, il lui faudrait des lecteurs munis d’une oreille très fine et de beaucoup de goût pour apprécier ces mêmes livres. Nous ne doutons pas que, s’il était réédité [1], René Bazin en trouverait de tels. Ses romans (dont, il faut le dire, les titres ne sont pas toujours heureux : Davidée Birot, Gingolph l’abandonné… de tels titres sont décourageants, alors que la teneur de ces deux romans est de belle qualité !), en effet démodés mais intéressants, ont à la fois beaucoup de netteté et de rigueur et, bien qu’ils ne soient pas roses, de douceur. Ne sont-ce pas là les caractères mêmes de la vérité ?
[1]Signalons l’Association des Amis de René Bazin; fort active, cette société dispose d’un excellent site «internet» : http://www.renebazin.org qui signale rééditions (sur papier ou sur internet), études, témoignages, etc.